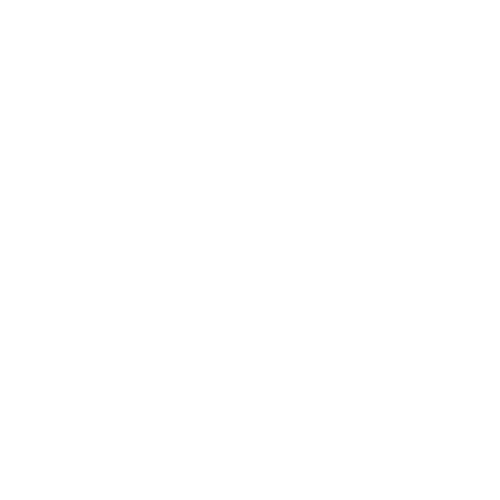Indépendant, mais avec quel statut ?
Se lancer en tant qu’indépendant, c’est faire le choix de l’autonomie et de la flexibilité. Mais au-delà des promesses d’un quotidien sans patron, la première décision à prendre est celle du statut juridique. Autoentreprise, EURL, SASU, portage salarial… Chaque option a ses avantages et ses contraintes. Un mauvais choix peut vite devenir un frein administratif ou financier. Décryptage des principales alternatives pour structurer son activité de freelance de façon optimale.
L’autoentreprise : simplicité maximale, mais plafonds contraignants
Le régime de la microentreprise (anciennement autoentreprise) est le plus accessible. Une inscription en ligne, un régime fiscal simplifié, des charges proportionnelles au chiffre d’affaires : c’est la porte d’entrée idéale pour tester une activité indépendante sans se noyer dans la paperasse.
Mais cette simplicité a un prix. Le chiffre d’affaires est plafonné à 77 700 € pour une activité de prestation de services en 2024, ce qui limite la croissance. De plus, la TVA n’est pas facturée sous un certain seuil, ce qui peut poser problème auprès de clients professionnels qui la récupèrent normalement. Enfin, le calcul des cotisations sociales, bien que forfaitaire, n’offre pas la meilleure couverture en cas d’arrêt d’activité.
L’EURL et la SASU : plus de protection, mais plus de gestion
Créer une entreprise unipersonnelle permet d’aller plus loin : l’EURL (forme unipersonnelle de la SARL) et la SASU (version solo de la SAS) sont les deux options principales. Ces structures permettent d’avoir une protection juridique plus solide et de ne pas être limité par des plafonds de chiffre d’affaires.
L’EURL impose un statut de travailleur non salarié (TNS) avec des charges sociales plus faibles, mais un régime moins protecteur en matière de chômage et de prévoyance. La SASU, elle, permet de rester affilié au régime général de la Sécurité sociale, mais avec des cotisations plus élevées.
L’inconvénient majeur de ces statuts est la gestion administrative plus lourde. Tenue de comptes, déclarations fiscales et obligations comptables sont bien plus complexes qu’en microentreprise, nécessitant souvent l’aide d’un expert-comptable.
Le portage salarial : sécurité maximale, mais coût plus élevé
Le portage salarial est une alternative hybride entre salariat et entrepreneuriat. Il permet d’exercer une activité indépendante tout en bénéficiant des avantages sociaux d’un salarié (assurance chômage, retraite, mutuelle). Concrètement, le freelance signe un contrat avec une société de portage, qui facture les clients à sa place et lui verse un salaire après prélèvement des charges.
Ce statut est idéal pour ceux qui veulent sécuriser leur transition vers l’indépendance ou qui travaillent avec des grands comptes exigeant des factures émanant d’une entreprise. Son principal inconvénient est son coût : la société de portage prélève une commission (généralement entre 5 et 10 % du chiffre d’affaires), en plus des charges sociales classiques.
A retenir
Il n’existe pas de statut parfait, seulement des choix adaptés à différents profils. L’autoentreprise est idéale pour débuter, l’EURL et la SASU offrent plus de liberté pour les projets ambitieux, et le portage salarial assure une tranquillité d’esprit aux freelances recherchant une protection sociale optimale.